Quand je regarde l'écran, l'écran me regarde.
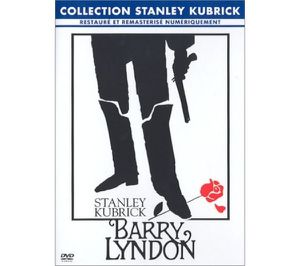
Un film de Stanley Kubrick (1975) avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Hardy Kruger & Patrick Magee.
Titre original : Barry Lyndon
Un DVD Warner zone 2 (2001), 178 min.
Résumé : Redmond Barry est une jeune Irlandais idéaliste et romantique, quoique ambitieux. Epris de sa cousine, il provoque son prétendant, un officier anglais, en duel. L’ayant blessé, il se voit contraint de quitter le pays. Sans le sou, il finira par s’engager dans l’armée anglaise pour guerroyer contre les Français en Prusse. Là-bas, grâce à un peu de débrouillardise et un grand sens opportuniste, il désertera pour être à nouveau forcé de s’engager… dans l’armée prussienne avant de la quitter à nouveau pour suivre un Chevalier libertin sillonnant les cours européennes pour y tricher aux cartes. C’est ainsi qu’il fait la connaissance d’une jeune veuve, Lady Lyndon, qu’il entreprend de conquérir afin de parvenir au statut qu’il a toujours recherché…
Une chronique de Vance
Avant -dernier film inscrit dans le cadre du Marathon Kubrick lancé par Cachou (cliquez sur son pseudo pour en avoir sa propre version).

Depuis le succès de 2001, Kubrick estimait être enfin libre de réaliser un film sur Napoléon, son projet le plus personnel, pour lequel il envisageait Jack Nicholson dans le rôle titre. Des repérages avaient même été faits, un scénario écrit ainsi qu’un montage financier ambitieux pour 35 000 figurants – mais les circonstances en avaient décidé autrement. N’empêche, après la réussite incontestable d’Orange mécanique et la liberté totale que lui conférait son contrat avec Warner, il se vit offrir l’occasion de créer un film à grand spectacle en costumes d’époque.
C’est en lisant les Mémoires de Barry Lyndon, un roman de William Makepeace Thackeray (1844) rédigé à la première personne, que Stanley Kubrick redéploya l’énergie emmagasinée pour son Napoléon inachevable. Il s’agissait de travailler sur le matériau qu’il appréciait le plus : la folie. Il préférait largement une histoire fondée sur des personnes, leur évolution, leur « vie intérieure » et leur destin, plutôt que sur des péripéties et de l’action en continu. Ayant les mains libres, Kubrick va s’en donner à cœur joie et développer autant que possible sa minutie, sa recherche constante du plan parfait et de l’éclairage idéal (n’oublions pas qu’il est avant tout photographe avant d’être un conteur) ainsi que du script pur, celui qui se retrouve débarrassé du poids de la censure et de certains principes éculés. Il estimait ainsi qu’une bonne histoire n’avait besoin que de 6 à 8 éléments fixes pour être complète, le tout était de trouver un moyen d’assembler ces éléments de façon harmonieuse sans heurter l’esprit du spectateur, mais sans non plus lui imposer de points de vue parasitaire (il se refuse normalement à tenter d’expliquer pourquoi un personnage a évolué de telle façon, se contentant de montrer ce qui lui est arrivé). Un travail d’épure scénaristique qui explique pourquoi, dès Folamour, ses films semblent réduits à quelques séquences-clefs (mais magistrales et filmées sur la longueur). Et pourquoi il se complaît dans des séquences muettes, laissant parfois un morceau de musique judicieusement choisi emplir le fond sonore et orienter un spectateur dérouté.
Dans Barry Lyndon, Kubrick va plus loin que jamais. Comme le dit Cachou, et tel que de nombreux critiques l’ont admis, il « peint avec de la lumière » (dixit Paul Duncan) et va exposer à l’écran des images directement inspirées de tableaux de grands maîtres de l’époque (Watteau et Gainsborough en tête – ce dernier pour ses ambiances éthérées – mais aussi Hogarth, Reynolds ou Chardin). Mozart, Vivaldi ou Haendel lui offriront un répertoire adapté (jamais la Sarabande n’a été aussi bien mise en images) et il s’évertuera à filmer autant que possible dans des demeures d’époque, allant jusqu’à tourner entre deux visites guidées ; pour une fois, aucun plan n’a été effectué en studio ! Pareil pour les costumes, il en a acheté une certaine quantité qu’il a fait copier.
Enfin, il choisit de pousser son perfectionnisme jusqu’à vouloir filmer avec la lumière naturelle. Les scènes nocturnes sont donc éclairées à la bougie, et il lui a fallu user d’objectifs spécifiques mis au point par Carl Zeiss pour la NASA afin de retranscrire à l’écran ces séquences aux teintes douces et granuleuses à nulles autres semblables.
Le résultat est somptueux. Le rythme est lent, scandé par les déboires du pauvre Redmond (enfin, la plupart du temps, il a bien cherché ce qui lui arrive) et on s’aperçoit que Kubrick ajoute les zooms à ses techniques de prises de vue, donnant souvent l’impression d’entrer dans (ou de sortir d’) une toile de maître. Les paysages sont magnifiés et que dire de ces jardins à la française, écrins uniques dans lesquels il insère des personnages soudain réduits à l’état de pantins.
C’est que Kubrick déroute encore par cette austérité froide, cette recherche esthétique qui entraîne une distanciation assez nette et empêche de vraiment s'attacher aux personnages, d'autant que les deux acteurs principaux sont assez inexpressifs, même s'ils révèlent des émotions intenses par la magie du montage. En effet, Ryan O’ Neal n’est pas le comédien le plus doué de sa génération ; son visage poupin collait assez à la première heure du film, son air juvénile soulignait la candeur inhérente à Redmond Barry. Mais on se rend surtout compte que le metteur en scène se contente de le placer en situation avec un air neutre, s’amusant avec le montage, la lumière et la musique pour donner du sens. A vrai dire, si c’est déstabilisant, c’est aussi sans doute volontairement troublant, on ne sait que penser de ce garçon pataud mais sincère qui devient soldat, déserte, redevient soldat puis espion avant d’être le valet et le garde du corps d’un tricheur mondain pour aboutir comme époux consort d’une femme noble. L’expérience l’a endurci, l’a rendu cynique et l’a sans doute perverti. Il n’en montre pas moins une réelle adoration pour son fils (on pourra toujours douter de ses sentiments pour Lady Lyndon et on est plus que circonspect devant son attitude lors du duel avec Lord Bullingdon, son beau-fils) mais, en le perdant, il se révèle perdu pour le monde. Trop obtus pour savoir saisir les bonnes opportunités, trop fier aussi, ou trop naïf, il se retrouve dans la peau d’un homme qu’il a servi quelques temps : le Chevalier, parcourant l’Europe en jouant aux cartes.
Triste fin, amère et sans gloire pour un individu qui n’a pu faire que l’effleurer. On l’a aimé, il s’est refusé à aimer en retour, visant ailleurs, plus haut, trop haut pour lui. Son tempérament, sa nature profonde ont ressurgi le temps d’une provocation, et cela lui a fermé les dernières portes qui auraient pu lui permettre d’accéder à la noblesse.
Grande fresque ambitieuse et réussie, où l’émotion transparaît par moments mais demeure la plupart du temps voilée par la perfection de la mise en scène.
Visionné en V.O.S.T. 5.1 : ambiance sonore très équilibrée, ample et très intelligible. Mais la jaquette du DVD annonçait du 16/9e alors qu’il a été diffusé en 4/3. Sacrilège ! Vivement le blu-ray, qui se révèle indispensable.
Dernier film du Marathon : 2001, l’Odyssée de l’espace.